« Des ponctions sur les richesses »
Entretien avec Claude Serfati
PARIS – german-foreign-policy.com s’est entretenu avec Claude Serfati au sujet du réarmement dans l’Union européenne, du « keynésianisme militaire » et de ses conséquences. Pour Serfati, les dépenses militaires ne sont pas productives « dans le sens de création de richesse » d’un pays ; elles sont plutôt « une ponction ». L’idée que les technologies militaires stimuleraient les technologies civiles est une idée seulement « circonstancielle ». L’espoir que la France « pourrait utiliser son avantage comparatif dans la défense pour compenser sa faiblesse industrielle face à l’Allemagne » a été déçu. Aujourd’hui, « la radicalisation de l’état bonapartiste et l’affaiblissement du capitalisme français » sont « une source de la radicalisation vers l’extrême droite». Serfati est économiste, chercheur associé à l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) à Paris et membre du conseil scientifique d'ATTAC-France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Le militaire. Une histoire française (Paris 2017), L’État radicalisé. La France à l’ère de la mondialisation armée (Paris 2022) et Un monde en guerres (Paris 2024).
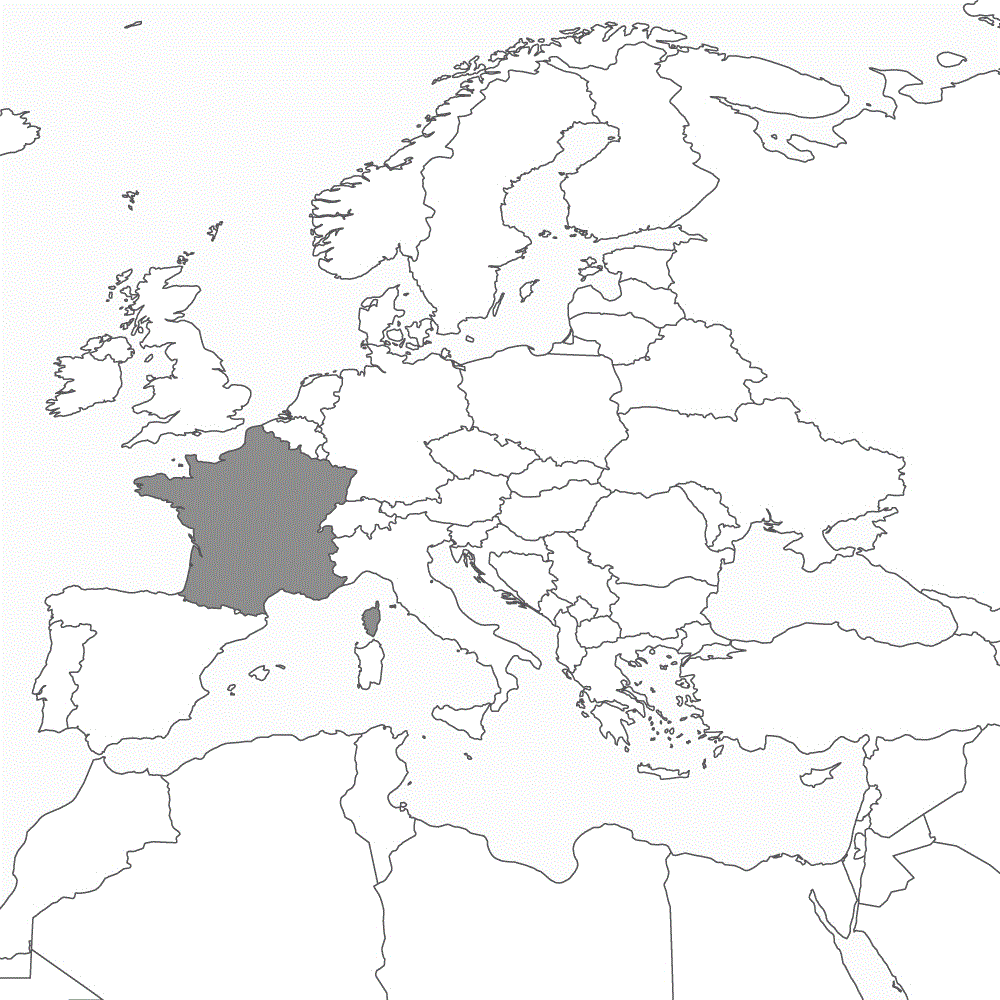
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)