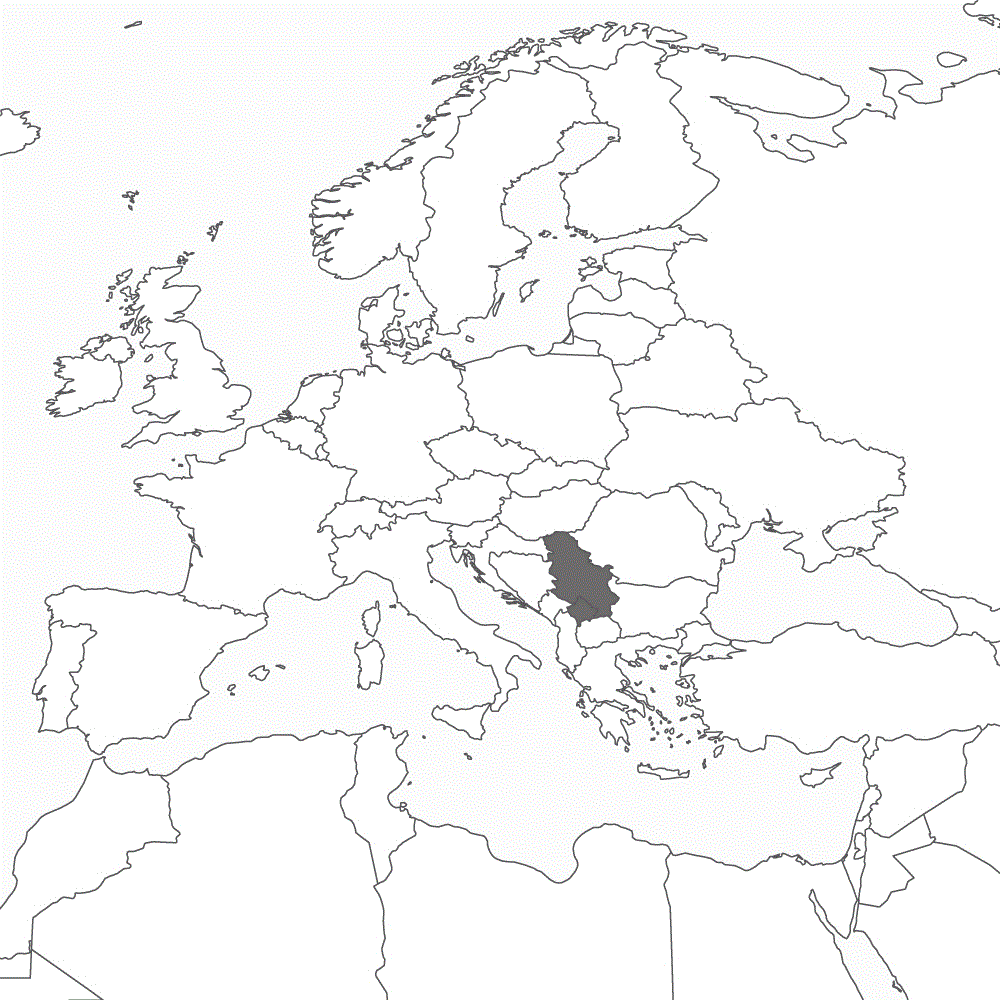Du Kosovo à la Lituanie
Berlin a prolongé la mission de la Bundeswehr au Kosovo. La guerre en Yougoslavie en 1999 a marqué un tournant dans la remilitarisation de la politique de puissance allemande. Depuis lors, l'armée allemande est de retour en Europe de l'Est.
BERLIN/PRISTINA (rapport exclusif) – L'Allemagne maintiendra sa présence militaire au Kosovo pendant une année supplémentaire. C'est ce qu'a décidé le Bundestag jeudi dernier. La Bundeswehr est stationnée au Kosovo depuis maintenant 26 ans, avec pour objectif déclaré de stabiliser la région. Au cours des dernières années, la situation a toutefois dégénéré à plusieurs reprises en violents affrontements. La sécession du Kosovo de la Serbie, imposée par l'OTAN avec la participation de l'Allemagne depuis la guerre de Yougoslavie en 1999, n'est toujours reconnue que par moins de la moitié des États membres de l'ONU. Aujourd'hui, la République fédérale n'est pas seulement une puissance d'occupation au Kosovo, elle a également continuellement renforcé son influence militaire en Europe de l'Est dans le cadre de la lutte géostratégique contre la Russie. La participation allemande à l'agression contre la Yougoslavie en 1999, contraire au droit international, a constitué une étape décisive sur la voie du retour des forces armées allemandes en Europe de l'Est et de la remilitarisation de la politique de puissance allemande. Entre-temps, Berlin construit sa première base militaire permanente à l'étranger en Lituanie, dans une région où l'Allemagne a autrefois mené sa guerre d'extermination contre l'Union soviétique.
26 ans d'intervention armée
Selon la demande du gouvernement fédéral visant à prolonger le mandat, l'objectif de l'intervention est d'assurer la « sécurité militaire de la solution pacifique » après la sécession violente du Kosovo de la Serbie en 1999 et la déclaration officielle d'indépendance de la région en 2008.[1] Au regard de cet objectif, les succès de cette mission, qui a mobilisé plus de 95 000 soldats allemands au Kosovo depuis son lancement, sont limités.Moins de la moitié des États membres de l'ONU reconnaissent le Kosovo comme un État à part entière, et donc la sécession de la province serbe par l'OTAN. L'acceptation est même en recul.[2] L'accord de normalisation entre la Serbie et le Kosovo, poussé par Berlin, risque de sombrer dans l'insignifiance faute de mise en œuvre concrète. La situation sécuritaire reste également précaire. Depuis 2022, des affrontements violents ont éclaté à plusieurs reprises, notamment des attaques meurtrières contre la police kosovare.[3] Le gouvernement fédéral allemand admet que « des détériorations et des aggravations à court terme de la situation sécuritaire sans avertissement préalable notable » sont « possibles à tout moment ».[4]
Intérêts allemands
Au-delà des objectifs régionaux au Kosovo, l'Allemagne affiche avec ses troupes « sa présence dans la région géostratégique clé des Balkans occidentaux », poursuit la motion du gouvernement fédéral.[5] Au Bundestag, les orateurs des partis au pouvoir étaient unanimes : l'intervention de la Bundeswehr au Kosovo exprime une importance géostratégique dans le contexte de la lutte d'influence des grandes puissances en Europe de l'Est et du Sud-Est. La présence militaire allemande au Kosovo n'est « pas seulement une contribution solidaire à la région », mais sert « également nos propres intérêts », a déclaré Marja-Liisa Völlers (SPD), membre de la commission de la défense du Bundestag. Il s'agit de « protéger la région contre l'influence croissante d'acteurs autoritaires », à savoir la Russie, et probablement aussi la Chine.[6] Berlin ne parvient manifestement pas à assurer son influence en Europe du Sud-Est par des moyens économiques et politiques seuls. Hier jeudi, le Bundestag a donc décidé de prolonger le mandat de la Bundeswehr d'une année supplémentaire.
Briser un tabou en 1999
En participant à la guerre en Yougoslavie en 1999, qui a entraîné la sécession violente du Kosovo, la République fédérale d'Allemagne a brisé un tabou historique. En 1945, l’Allemagne avait non seulement perdu son armée, mais aussi toute emprise sur sa sphère d’influence exclusive en Europe de l’Est et du Sud-Est.54 années se sont écoulées entre la démilitarisation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et la première participation de la Bundeswehr à une guerre d'agression, qui a constitué à plusieurs égards une rupture avec l'ordre d’après-guerre. Sur le plan de la politique intérieure, la participation à la guerre a porté un coup décisif aux forces politiques qui, après deux guerres mondiales, réclamaient une culture de la retenue militaire. Sur le plan de la politique étrangère, Berlin a ouvertement violé le droit international avec cette agression militaire. En démantelant la Yougoslavie, elle a affaibli un rival régional et modifié les frontières en Europe par la force des armes.Enfin, l'Allemagne est revenue en tant que puissance d'occupation militaire dans le sud-est du continent.
Nouvelle « conscience de soi »
Avec l'attaque contre la Yougoslavie en 1999 et les guerres qui ont suivi, notamment en Afghanistan et au Mali, l'abandon de la retenue militaire historiquement fondée et la remilitarisation de la politique de puissance allemande ont pris de l'ampleur. Dans le contexte de la Conférence de Munich sur la sécurité en 2014, les dirigeants politiques allemands ont alors appelé de concert à une nouvelle « confiance en soi » de la République fédérale en matière de politique étrangère et militaire ; certains ont parlé du « consensus de Munich ». Certains Allemands, a déclaré l'ancien président fédéral Joachim Gauck, « utilisent la culpabilité historique de l'Allemagne » pour « cacher leur confort ». Les voix de la retenue, contre lesquelles Gauck se voyait encore contraint de s'exprimer en 2014, se sont désormais tues en grande partie. Le ministre de la Défense Boris Pistorius exige de la population allemande qu'elle soit « apte à la guerre » ; le chancelier fédéral Friedrich März déclare devant le monde entier que l'Allemagne veut devenir la première puissance militaire conventionnelle d'Europe. Depuis 2018, la capacité de mener une guerre contre une grande puissance est à nouveau une mission fondamentale de la Bundeswehr.
Retour en Europe de l’Est
Depuis 2023, l’Allemagne revendique également la position de « pilier fondamental » de la guerre conventionnelle de l’OTAN et de l’UE en Europe.[7] Dès 2014, l'ancienne ministre de la Défense Ursula von der Leyen avait commencé, dans un premier temps avec une relative prudence, à réorganiser et à réarmer la Bundeswehr en vue d'une guerre contre la Russie. Depuis lors, la Bundeswehr s’entraîne lors de manœuvres de plus en plus vastes à se déployer et à mener une guerre contre la Russie en Europe de l’Est.[8] Elle participe à la mise en place d'unités de l'OTAN en vue d'une éventuelle guerre sur le flanc est et participe à la surveillance de l'espace aérien dans les pays baltes. Depuis 2017, des soldats allemands sont également stationnés en Lituanie et sont en train d'établir la première base militaire allemande permanente à l'étranger, dans une région où l'Allemagne a autrefois mené sa guerre d'extermination contre l'Union soviétique.[9] En Roumanie également, des avions de combat allemands sont régulièrement stationnés depuis des années et participent à des vols armés au-dessus de la mer Noire. Si la guerre en Yougoslavie en 1999 a été la première étape du retour militaire en Europe de l'Est, la Bundeswehr est aujourd'hui présente tout le long du flanc ouest de la Russie, de la mer Baltique à la mer Noire.
[1] Proposition du gouvernement fédéral : poursuite de la participation des forces armées allemandes à la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR). Bundestag allemand, document 21/230. Berlin, 21 mai 2025.
[2] Voir à ce sujet Plus d'OTAN pour le Kosovo.
[3] Voir à ce sujet Troubles au Kosovo, Troubles au Kosovo (II), Troubles au Kosovo (III) et Troubles au Kosovo (IV).
[4], [5] Motion du gouvernement fédéral : Poursuite de la participation des forces armées allemandes à la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR). Bundestag allemand, document 21/230. Berlin, 21 mai 2025.
[6] Discours de Marja-Liisa Völlers au Bundestag allemand.
Berlin, 26 juin 2025.
[7] Lignes directrices en matière de politique de défense 2023. Bonn, novembre 2023. Voir à ce sujet « L'aptitude à la guerre comme principe d'action ».
[8] Voir à ce sujet Les troubles au Kosovo et Au bord de la guerre.
[9] Voir à ce sujet Une nouvelle ère.